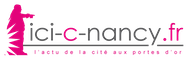Quelques heures avant la première, Bertrand Sinapi, metteur en scène d’Hamlet ou La Fête Pendant la Peste, et Amandine Truffy, que les spectateurs retrouveront sur scène dans le rôle d’Ophélie, ont accepté de répondre à nos questions...
Quelques heures avant la première, Bertrand Sinapi, metteur en scène d’Hamlet ou La Fête Pendant la Peste, et Amandine Truffy, que les spectateurs retrouveront sur scène dans le rôle d’Ophélie, ont accepté de répondre à nos questions...
Ils évoquent alors la démarche qui les a poussés a poursuivre avec cette « variation » sur le thème d’Hamlet un geste d’écriture commencé au XIIe siècle. Mais aussi comment ils ont compris le dilemme d’action d’Hamlet ; octroyé à Ophélie une place équivalente à celui du héros éponyme dans une époque où le personnage féminin ne peut plus se réduire au rang d’outil de la narration. Ils parlent également de politique et de regard sur le monde. Rencontre avec deux créateurs prêts à l’action !

![]() Qu’est-ce qui vous a donné envie de monter Shakespeare, et particulièrement une pièce aussi importante dans son œuvre qu’ Hamlet ?
Qu’est-ce qui vous a donné envie de monter Shakespeare, et particulièrement une pièce aussi importante dans son œuvre qu’ Hamlet ?
Bertrand Sinapi : On a pour habitude de travailler sur des textes contemporains, et le plus souvent à partir de « sources », c’est-à-dire qu’on a rarement monté des textes théâtraux écrits complètement sans les retoucher. En général nos spectacles sont assez différents les uns des autres parce qu’on essaie de se placer par rapport au moment où on est, par rapport à l’état dans lequel on est, par rapport au monde dans lequel on vit, à la façon dont on le réceptionne, et dont on a envie d’en parler.
Hamlet ça s’est imposé parce qu’on a décidé de se positionner par rapport à la question « De quoi on parle si on parle d’aujourd’hui ? ». C’est assez rigolo là où ça nous a emmenés puisqu’on a pris justement un texte qui n’est pas du tout d’aujourd’hui… Et on a eue la sensation que la question qui finalement se posait pour nous à notre âge, c’était : « Comment on se place par rapport au monde d’aujourd’hui et comment on agit à l’intérieur ? » Donc très vite on a parlé du pouvoir. On a entamé un certain nombre de cycles de travaux à travers différentes villes européennes, et on s’est aperçus que derrière cette question du pouvoir, ce qui nous intéressait fondamentalement, c’était la question de l’action et de l’inaction. C’est-à-dire : est-ce qu’on agit, est-ce qu’on n’agit pas ; qu’est-ce que ça veut dire « agir », qu’est-ce que ça sous-entend, qu’est-ce que ça demande comme implication ?
On a deux projets formellement très différents sur cette thématique, mais Hamlet est très vite arrivé dans le corpus de textes, parce que Hamlet c’est justement ce personnage qui se demande s’il doit agir ou pas. C’est un personnage qui enrage, qui est en lutte dans une espèce de monde prêt à exploser, ce qui nous semble parfois pas loin de l’époque dans laquelle on vit, et puis surtout c’est un personnage qui se place dans cette question plus ou moins universelle pour quelqu’un de son âge : Qu’est-ce qu’on fait de son héritage, et comment on va contre ceux qui sont « au-dessus de nous » dans ces relations de pouvoir ?
Le choix du texte classique, c’est arrivé en deuxième lieu ! D’abord on a travaillé sur le texte d’Heiner Müller, Hamlet-Machine, et très vite ce qui nous a semblé intéressant, ça a été de prendre ce texte classique, et d’y inclure un certain nombre de points de résonnance. Ce que fait Shakespeare à l’époque puisqu’il prend déjà un texte qui le précède, il en fait une pièce de théâtre, et il y introduit un certain nombre de références de son époque. On a essayé de faire quelque chose de cet ordre, mais pas de manière très explicite parce que l’idée ce n’est pas de contextualiser Hamlet aujourd’hui, de faire Hamlet dans une entreprise, dans une multinationale, par exemple ! Il s’agit vraiment de prendre la même structure, mais par jeux de couches, d’ajouts, de retraits, de faire correspondre ce texte au type de résonnance qu’il avait, en changeant la façon dont il se déroule au niveau du temps ; en changeant aussi un certain nombre d’éléments au niveau de la façon dont l’histoire se construit, et en reprenant un certain nombre de citations ou d’articles de journaux. Le discours de Claudius au début est notamment basé sur un discours d’Hamid Karzaï et sur celui d’un premier ministre israélien. L’idée est de prendre un certain nombre de sources actuelles et de les faire cohabiter dans cette pièce tout en gardant une forme proche du texte original.
![]() Votre adaptation s’intitule Hamlet ou La Fête Pendant la Peste. Pouvez-vous nous expliquer ce titre ?
Votre adaptation s’intitule Hamlet ou La Fête Pendant la Peste. Pouvez-vous nous expliquer ce titre ?
Bertrand Sinapi : Tout d’abord, le mot « adaptation » ne nous semble pas totalement juste. Je sais qu’il n’y en a pas tellement d’autres qui décrivent ça, si ce n’est celui que nous avons utilisé, qui est celui de « variation ». En musique, une variation reprend tous les éléments ou un certain nombre d’éléments significatifs de la pièce originale et en fait autre chose. Cela nous semble plus proche de ce qu’on a fait, parce qu’on n’a pas vraiment « adapté » le texte.
Amandine Truffy : Oui, c’est ça. On a bien utilisé, nous, le terme de «variation » comme en musique. C’est-à-dire qu’on reconnaît le thème original, mais il y a de légères modifications qui font que c’est autant autre chose que la pièce originale.
Bertrand Sinapi : Pour ce qui est du titre, Hamlet ou la Fête Pendant La Peste, justement l’idée était de pouvoir dire que ce n’était pas que Hamlet, pas complètement Hamlet. Il nous fallait donc une sous-couche, et on est arrivé assez rapidement à ce titre.
« La Fête Pendant la Peste » c’est à la fois l’idée de faire une fête quand dehors tout est en train de mourir, quelque chose d’assez vain et pessimiste qui peut correspondre à des moments du monde dans lequel on vit : des endroits s’agitent, vivent, sur-vivent même et surconsomment, pendant que d’autres endroits dépérissent. Et en même temps, c’est aussi l’espoir quand tout meurt. Le texte fait pas mal de citations… « La Fête Pendant la Peste » ça se retrouve chez pas mal d’auteurs. Elsa Triolet en parle dans un discours, Stanislavski aussi… C’est quelque chose qu’on a eu l’impression d’inventer. Même moi, pour être honnête, j’ai écrit cette phrase en ayant ces idées, et après je l’ai découverte chez plusieurs auteurs, même un Russe dont j’ai oublié le nom ! Et tout cela a contribué à construire notre projet. Il y a tout un pan de la réécriture qui est de moi mais il y a aussi, je crois, une trentaine d’œuvres qu’on peut retrouver dans le texte qu’on va jouer ce soir… Je ne sais pas si tout le monde va les voir, ni combien on va en voir, mais normalement il y a suffisamment d’éléments pour que ça puisse résonner, pour qu’on se dise : « Ca, ça ne peut pas être dans le texte original » et qu’on prenne un peu de distance par rapport aux événements qui se déroulent.
Amandine Truffy : Et puis « La Fête Pendant la Peste », c’est aussi en résonnance par rapport au fait de continuer à faire du théâtre, de se retrouver ensemble pour penser le monde. C’est être à l’extérieur et à l’intérieur en même temps, et chanter quelque chose au moment où tout s’écroule. C’est peut-être le moment où on a le plus besoin d’être ensemble d’ailleurs.
![]() Justement, vous me dites que Shakespeare lui-même s’est inspiré d’une autre pièce ; que vous, vous réécrivez d’une certaine façon la pièce de Shakespeare ; que vous citez d’autres auteurs en même temps et puis qu’il y a quand même une grande part de création personnelle. Comment on se réapproprie tout ce matériau ?
Justement, vous me dites que Shakespeare lui-même s’est inspiré d’une autre pièce ; que vous, vous réécrivez d’une certaine façon la pièce de Shakespeare ; que vous citez d’autres auteurs en même temps et puis qu’il y a quand même une grande part de création personnelle. Comment on se réapproprie tout ce matériau ?
Bertrand Sinapi : Je ne sais pas… Comme ça ?
Non mais justement, une des raisons du choix d’Hamlet, c’est parce que c’est la pièce mythique du théâtre, son chef-d’œuvre, c’est l’Everest ! C’est aussi une pièce impossible à monter d’une certaine manière, parce qu’elle est compliquée de plein de points de vue. Et c’est l’une des raisons qui fait qu’elle est régulièrement montée partout à-travers le monde, je pense. C’est-à-dire qu’on peut y projeter des tas de choses. Et il y en a eu des tas, de réécritures. De ce que j’ai lu, Hamlet est le texte le plus commenté après La Bible !
Donc, comment on se réapproprie ça ? En s’inscrivant dans une lignée. Le premier texte date du XIIe siècle. C’est une chronique d’une légende danoise qui a déjà subi plusieurs transformations avant que Shakespeare la découvre. Il en a lui-même fait trois versions, et en général, les traductions qu’on lit sont soit une de ces trois versions, soit des mélanges de ces trois versions. Et après, il y a eu des tas de réécritures, donc c’est en s’inscrivant là-dedans que ça devient logique pour moi, dans le fait que ce geste d’écriture continue.
Une des grandes questions d’Hamlet est celle de la vanité. Ce n’est peut-être pas sa question philosophique première, puisque ça je crois que c’est plutôt la question de l’action / de l’inaction, ou celle de la vengeance, mais c’est l’une des questions centrales. A quoi ça sert ce qu’on va faire ce soir ? Les gens vont venir, ils seront contents ou pas contents, mais qu’est-ce qui va se passer ? Finalement, ce qui n’est pas vain, c’est de vivre.
C’est un spectacle dans lequel tout le monde meurt, et d’un autre côté c’est faux, car on est au théâtre. On peut se dire que ce qu’on fait ne sert à rien, mais alors qu’est-ce qu’on fait ? Rien ! Le fait de tenter quelque chose, même au risque de le rater, c’est pour moi la seule chose qui vaille. Tenter, essayer des choses, aller vers ce qui nous semble important à faire. Et je crois que c’est cela qui traverse Hamlet.
Au début de la pièce, il est dans un monde où il n’a plus de place, tout seul. Son oncle vient de se marier avec sa mère. Il n’a pas de cause, et il en attend une. Le spectre de son père vient lui en donner une : « Viens me venger ». Mais c’est une cause qui est trop grande pour lui. Si le spectre n’apparaissait pas, Hamlet ne mourrait pas. Donc que doit-il faire pour trouver une raison de vivre ? La pièce lui donne des tas et des tas de raisons… qui le mènent à la mort.
![]() Qu’est-ce qui rend cette pièce toujours si actuelle ?
Qu’est-ce qui rend cette pièce toujours si actuelle ?
Bertrand Sinapi : Ah, c’est amusant, on m’a posé pratiquement la même question hier. C’est une question logique mais j’ai du mal à y répondre parce qu’il ne me semble pas vraiment que la pièce soit toujours actuelle. Sinon je l’aurais montée telle quelle !
En revanche, la thématique de la pièce n’est pas actuelle, elle est universelle !
Amandine Truffy : Elle se pose à chaque génération…
Bertrand Sinapi : Voilà. C’est la question de comment un jeune humain trouve sa place dans le monde, comment il agit. L’idée c’était justement de démontrer que la pièce de Shakespeare n’est plus actuelle et d’en faire quelque chose d’actuel. Mais pas en la changeant. La thématique est universelle, c’est la raison pour laquelle cette pièce, cette légende, traversent les siècles.
Et puis il y a une question dont on n’a pas parlée mais qui est très importante pour nous, c’est celle d’Ophélie. Dans la pièce de Shakespeare, Ophélie n’est qu’un outil de l’histoire. Pour nous c’était essentiel de faire en sorte qu’Ophélie ait une place très importante. Et c’est ce que fait Heiner Müller dans sa réécriture, Hamlet-Machine : il donne la place de la révolte à Ophélie. Dans ce qu’on a fait, Ophélie porte ce qui est d’une certaine manière l’action au théâtre, c’est-à-dire la parole. Ici elle n’est pas une poupée, elle n’est pas un outil de l’action. Elle est la ligne qui traverse la pièce et qui porte le sens de ce que nous essayons de dire. Je ne dirais pas qu’elle porte « le message » parce que nous ne sommes pas dans un rapport de moralisation ; nous n’essayons pas de dire aux spectateurs ce qu’ils doivent penser. Mais elle a une parole d’espoir, un espoir compliqué au milieu d’un monde qui meurt. Ce qui nous semble aussi être un peu la place qu’on occupe aujourd’hui, même si c’est très négatif de dire ça. Parce que ce n’est pas vrai, le monde n’est pas en train de mourir, évidemment, mais on est dans une époque, qui je pense, précède une révolution.
Aujourd’hui on vit dans un monde où tout est fait pour que rien ne puisse être détruit. Soit qu’on ait peur de perdre quelque chose et qu’on n’agisse pas. Je crois qu’on est une génération proche de la résignation. Cette tentation de la résignation est très forte. On le voit beaucoup dans la politique. On entend très vite des discussions telles que « De toutes façons la gauche ou la droite c’est pareil » ; « Ils sont tous pareils » ; « Tout est équivalent » ; « Et puis on n’y peut rien, le monde est comme ça ». Peut-être que c’est vrai, mais ça ne me convient pas.
On en revient alors à ce que je disais au début : Qu’est-ce qu’on fait ? Notre réponse à nous, c’est ça. Nous on fait du théâtre, même si ça peut aussi sembler vain.
![]() Et pourquoi justement avez-vous éprouvé l’envie de donner une telle importance au personnage d’Ophélie, qui effectivement est plutôt sacrifié dans la pièce originale ?
Et pourquoi justement avez-vous éprouvé l’envie de donner une telle importance au personnage d’Ophélie, qui effectivement est plutôt sacrifié dans la pièce originale ?
Bertrand Sinapi : Parce que d’abord ça nous permettait de mettre en champ ces deux questions de l’action et de l’inaction. Ensuite parce que justement il ne me semble pas possible ni opportun de montrer aujourd’hui une femme-objet !
C’est aussi par rapport aux thématiques qui nous intéressent. On a fait d’Ophélie non plus un outil qui permet à Hamlet de raconter son histoire mais un parallèle. Ce sont deux chemins qui se croisent et se re-séparent à deux endroits différents.
Il y en a un qui, au moment où il se met à agir, meurt, Hamlet ; et une qui dans la mort – parce que le théâtre le permet, parce qu’au théâtre on ne meurt pas vraiment – peut parler, peut révéler. Chez Shakespeare, il y a aussi quelque chose de cet ordre-là : Ophélie se met à déclarer la vérité dans ses accès de folie. Mais on peut aussi dire qu’elle devient tarée et qu’elle se suicide ! Du coup, ça pose aussi cette question difficile : est-ce que comme solution, on peut accepter le suicide ? On est au théâtre, la question que l’on pose est surtout celle de la résignation, comme je le disais. Mais elle se pose pour Hamlet ET pour Ophélie. Elle se résigne à ne pas survivre dans ce monde-là. Et nous on a transformé ça en faisant cohabiter ces questions.
Amandine Truffy : C’est aussi faire « vieillir » le récit au fil des époques, ce qui est déjà ce qui s’est passé, puisqu’il a été mis en écriture au XIIe siècle, mais c’est une légende orale qui date de bien avant. Elle a sans cesse été remise en écriture et c’est comme si cet Hamlet vieillissait au fur et à mesure. Enfin, il ne vieillit pas vraiment parce qu’il a toujours trente ans, mais il s’imprègne de toutes les couches des époques qu’il traverse et qu’à travers lui c’est l’humanité d’un moment qui vient s’ajouter.
Et faire ça avec Ophélie, avec toutes les révolutions qui ont eu lieu dans le domaine de l’égalité des droits hommes-femmes qu’on a vécu dans une partie du monde en tous cas depuis un siècle, c’est se demander ce qu’elle devient, elle-aussi, avec cette révolution qu’elle a dans les pattes ? Théoriquement maintenant, on a les mêmes droits, ce qui est une chose très neuve. On ne s’en rend pas compte. Je crois qu’on s’imagine que c’est acquis, mais je pense que c’est l’une des révolutions les plus importantes qu’il y ait eue au siècle dernier, et qui est encore en cours aujourd’hui dans ses conséquences. Et finalement c’est aussi rétablir une forme d’égalité dans cette pièce par rapport à ces deux destinées. Hamlet et Ophélie vieillissent ensemble, ont cette éternelle jeunesse qui s’imprègne de tout ce qu’ils traversent.
![]() Vous montez cette pièce au Théâtre de La Manufacture, qui est connu pour ses productions décalées, très contemporaines… Est-ce que cela vous apporte quelque chose en matière de création artistique de monter ce spectacle dans le cadre de ce théâtre ?
Vous montez cette pièce au Théâtre de La Manufacture, qui est connu pour ses productions décalées, très contemporaines… Est-ce que cela vous apporte quelque chose en matière de création artistique de monter ce spectacle dans le cadre de ce théâtre ?
Amandine Truffy : Nous, la création contemporaine, c’est le monde dans lequel on navigue. Bertrand est auteur, donc dans nos travaux, il y a toujours beaucoup de recherche personnelle. Après on va au Saulcy, qui est un théâtre aussi centré sur les jeunes écritures contemporaines. C’est assez drôle qu’il y ait Hamlet au milieu de ces programmations, et en même temps, c’est un Hamlet qui amène une tentative par rapport à ça, justement. L’écriture contemporaine est la poursuite d’un geste d’écriture commencé il y a bien longtemps. On essaie de fixer la pensée d’une époque, même avec Hamlet. Et oui, c’est une force. Parce que si on le montait perdu au milieu de classiques, il ne serait probablement pas à la juste place pour être entendu. C’était important qu’on le fasse ici, au milieu d’auteurs vivants !
![]() Dans votre note d’intention, vous déclarez : « Hamlet a été depuis sa création le mythe du jeune humain perdu dans le monde entre son action et son inaction. Ce jeune homme que tout pousse à la vengeance et qui n’agit pas est un miroir. Car agir pour Hamlet, c’est prendre le pouvoir ». Vous parlez donc très techniquement du pouvoir. Nous sommes en période électorale… Aviez-vous envie de dire quelque chose de la politique d’aujourd’hui, de ses rapports de pouvoirs précis ?
Dans votre note d’intention, vous déclarez : « Hamlet a été depuis sa création le mythe du jeune humain perdu dans le monde entre son action et son inaction. Ce jeune homme que tout pousse à la vengeance et qui n’agit pas est un miroir. Car agir pour Hamlet, c’est prendre le pouvoir ». Vous parlez donc très techniquement du pouvoir. Nous sommes en période électorale… Aviez-vous envie de dire quelque chose de la politique d’aujourd’hui, de ses rapports de pouvoirs précis ?
Bertrand Sinapi : Oui bien sûr. Après, comme je vous le disais, c’est une pièce qui est très ouverte, donc l’idée n’a pas été de fermer, de focaliser sur aujourd’hui en France, mais plutôt d’ouvrir sur une vision du monde. Sur la façon dont se construisent les rapports de pouvoir, sur ce que cela induit. On est plutôt dans l’idée universelle du rapport du pouvoir. Les personnages sont des archétypes.
Le discours de Claudius n’est pas là par hasard. Claudius représente l’homme politique dans le monde. Mais il n’est pas en train d’essayer de déterminer s’il faut supprimer les départements ou pas, par exemple. Il est dans un monde en guerre, où un mur est bâti. L’idée du mur, évidemment, fait référence à celui qu’Israël est en train de construire, mais en même temps, il y en a eu des tas de murs, dans l’histoire de l’humanité, de la Muraille de Chine à celui qui sépare les Etats-Unis du Mexique. Au bout d’un moment le problème c’est que quand on s’enferme derrière un mur, on ne sait plus si on l’a bâti pour se séparer des autres ou si on a construit sa propre prison.
On va dire qu’on propose une idée géopolitique générale. On essaie de faire des spectacles dans lesquels les spectateurs puissent projeter des choses à eux. On n’est jamais dans une démarche frontale. L’idée est qu’on donne aux spectateurs assez d’éléments pour qu’ils puissent construire leur propre histoire et leur propre pensée.
![]() Mais dans la mesure où le dilemme d’Hamlet est, vous l’avez bien souligné, un dilemme d’action, est-ce que ce n’est pas une façon d’appeler à l’action ?
Mais dans la mesure où le dilemme d’Hamlet est, vous l’avez bien souligné, un dilemme d’action, est-ce que ce n’est pas une façon d’appeler à l’action ?
Bertrand Sinapi : Une façon d’appeler à l’action, je pense que ce serait présomptueux de notre part. En revanche, ce que ce spectacle dit, c’est que nous, on a choisi d’agir, même si notre acte, c’est cette pièce.
C’est une tragédie révolutionnaire, parce qu’elle se finit dans la mort. Le monde tel qu’il existe dans Hamlet, à la fin de la pièce n’existe plus. Le Danemark avec son entité politique est détruit, puisque tout le monde meurt. Encore une fois on est au théâtre, ce n’est pas de la politique, mais…
Amandine Truffy : … Mais c’est un geste politique que de faire du théâtre.
![]() Justement la question du politique se pose beaucoup dans l’art. Votre position à vous, c’est donc que la création théâtrale est de toutes façons un geste politique ?
Justement la question du politique se pose beaucoup dans l’art. Votre position à vous, c’est donc que la création théâtrale est de toutes façons un geste politique ?
Bertrand Sinapi : Nous on n’est pas dans un théâtre de divertissement où l’on vient pour oublier ses soucis, c’est sûr. On essaie de proposer un théâtre qui amène le spectateur à réfléchir et à se positionner par rapport à un débat.
![]() Qu’est-ce que vous espérez qu’il ressorte de ce spectacle pour le public ?
Qu’est-ce que vous espérez qu’il ressorte de ce spectacle pour le public ?
Bertrand Sinapi : On ne sait pas… Peut-être juste que ça amène les gens à se positionner. Si un spectateur ressort en s’en foutant, alors c’est raté. Si un autre sort en n’étant complètement pas d’accord, alors c’est une forme de réussite. Evidemment on a toujours une envie d’adhésion. Que les gens soient heureux, se posent des questions. Le théâtre est un endroit qui amène la question de l’émotion. Être assis dans une salle et ressentir une émotion n’est pas quelque chose qui est donné tout le temps. Etre ému d’une situation, que ce soit en bien ou en mal, c’est pour moi une chose positive. Et quand on voit, après le spectacle, que les gens discutent de ce qui a été fait ; qu’ils sont d’accord, pas d’accord, s’animent ; on a l’impression d’avoir réussi quelque chose. C’est ce qu’on recherche.
![]() Vous évoquiez tout à l’heure un prochain projet avec une base similaire… Pouvez-vous nous en dire davantage ?
Vous évoquiez tout à l’heure un prochain projet avec une base similaire… Pouvez-vous nous en dire davantage ?
Bertrand Sinapi : Le prochain projet, celui qu’on attaque dans un mois et demi et qu’on monte à Pompidou en mai, c’est le même point de départ : l’action / l’inaction. Sauf que c’est une forme qui va être complètement explosée : une performance, pas vraiment une pièce de théâtre écrite mais plutôt une chose qui arrive et qui n’existe qu’au moment où c’est créé. L’idée c’est de jouer sur le hasard en donnant le pouvoir aux dés : ils choisissent pour nous, ce ne sera donc jamais formellement la même chose.
C’est donc complètement différent de ce qui se passe ce soir, puisqu’on est ici dans une forme de théâtre classique, répétée.
Délivrance, ce sera l’inverse : une espèce d’implosion ou d’explosion. Ce sont deux réponses. Peut-être qu’on n’a pas su choisir entre les deux. Peut-être que c’est aussi un choix : toujours est-il qu’à cette question de l’action et de l’inaction, on a voulu donner ces deux réponses-là.
Propos recueillis par Raphaëlle Chargois.