 Le 5 juin dernier, l’auteur américain Douglas Kennedy était présent à la librairie Stanislas, à Nancy, pour présenter aux nombreux lecteurs réunis à cette occasion son nouvel ouvrage, Combien, une investigation personnelle réalisée dans les années 1990, sur le milieu de la finance et des marchés financiers. Entre deux dédicaces, il a accepté de répondre à nos questions…
Le 5 juin dernier, l’auteur américain Douglas Kennedy était présent à la librairie Stanislas, à Nancy, pour présenter aux nombreux lecteurs réunis à cette occasion son nouvel ouvrage, Combien, une investigation personnelle réalisée dans les années 1990, sur le milieu de la finance et des marchés financiers. Entre deux dédicaces, il a accepté de répondre à nos questions…
Vous publiez Combien, une enquête sur le milieu de la finance, que vous avez menée dans les années 1990, et pas après les krachs boursiers, comme on aurait pu s’y attendre. Qu’est-ce qui a motivé cette démarche ?
J’ai écrit Combien juste avant mes romans, et vous savez que j’avais écrit déjà deux récits de voyage avant Combien. Pour moi il y a deux choses : mon ambition était de devenir romancier, mais à l’époque je n’avais aucune idée de comment écrire un roman, donc j’ai utilisé mes récits de voyage comme des romans d’actualité.
La foi des autres m’intéresse depuis toujours. Au Pays de Dieu, ça parlait des néo-chrétiens. La foi des gens, quelle est la raison d’être des vies des autres ? Ca m’intéresse énormément. Et l’argent est derrière toutes les vies. Même si on n’en a pas beaucoup, c’est toujours important. Parce qu’il faut « gagner sa vie ». Mais aussi parce que l’argent est une métaphore pour beaucoup de choses. Nos rapports avec l’argent expriment beaucoup de choses, qu’on soit avare ou généreux : nos rêves, nos désirs, nos peurs…
Donc j’ai décidé de voyager dans le pays de l’argent. Mais le livre est très éclectique : parti de Casablanca, j’ai visité des pays arabes. L’atmosphère et les racines du souk… J’ai été aussi à Sidney parce que le point de vue australien sur l’argent est très féroce, même avec le soleil, les plages, la mer… A Singapour parce que c’est un ex-pays du Tiers-Monde, qui dans le passé a été entièrement détruit et qui est maintenant hyper propre…
Pourquoi le rapport à l’argent change de pays à pays ?
Au départ, vous me parliez de vos précédents récits de voyage, où vous vous penchiez davantage sur le sujet de la religion. Pour vous l’argent, ça se situe sur le même plan que la religion ?
Tout à fait. Le truc, c’est que l’argent, c’est réel. Une foi religieuse, peut-être que c’est réel pour celui qui y croit, mais bon, ça reste théorique, parce qu’à ma connaissance, personne n’a vu Dieu ! Mais l’argent comme religion, comme raison d’être, oui. En même temps, dans le livre, j’essaie de voyager de façon métaphorique sous le vernis : on peut voir un homme d’affaires et penser qu’il a tout : la jaguar, le costume très élégant, que c’est un type qui veut gagner, gagner, gagner. Mais il y a toujours un mal derrière. J’ai fait en sorte, dans le livre, de découvrir le rapport des uns et des autres à l’argent. Parce qu’au fond, derrière toutes ces histoires, il y a beaucoup de tristesse.
Ce livre, c’est une démarche que vous avez entreprise dans les années 1990, et entre temps, il y a eu la crise des Subprimes. Quel regard portez-vous à présent sur les rapports financiers que vous analysiez il ya plus de 20 ans au vu de ces événements-là ?
Je pense que dans les années 1980 avec Reagan et Thatcher, le rapport à l’argent a changé : l’argent est devenu sexy. Quand j’étais à l’université pendant les années 1970, si on disait : « Je veux devenir riche », tout le monde pensait « Quel connard ! » Maintenant, c’est un but. Dans les années 1980, à cause des bourses, les salaires des Golden Boys à Wall Street ont gonflé – pas augmenté, gonflé – pour atteindre 2 ou 3 millions de dollars par an – franchement de nos jours ce n’est plus rare, maintenant c’est le minimum, la plupart du temps, et c’est la même chose à La City à Londres, ou à Francfort – et résultat, toutes les grandes villes ont changé. Les capitales, New York, Paris, sont de moins en moins abordables pour les classes moyennes, parce que ça devient de plus en plus des villes de riches ! Et ça, c’est tragique. Le fait que toutes les professions intellectuelles ont été dévaluées, aussi, c’est terrible et injuste. Maintenant, il y a un prix à tout. Même chez les écrivains. On vous demande quels sont vos chiffres, dans toutes les maisons d’éditions. Si vos chiffres sont bons, ok, si vos chiffres sont mauvais, on ne va peut-être pas continuer avec vous. J’espère que le mouvement Occupy va marquer symboliquement le début d’un changement. Mais ce cycle de toute-puissance de l’argent dure depuis maintenant plus de vingt ans ! J’espère que ça va changer, que ça va diminuer un peu. Mais au fond, je crois que l’argent sera toujours là.
Est-ce que c’est aussi une façon de prendre le contre-pied d’une certaine littérature des années 1980 qui a fait du personnage du Golden Boy un héros ?
Oui mais ça renvoie aussi à des romans de cette époque, si on a lu par exemple, - j’ai oublié le titre en français – le roman le plus célèbre de Tom Wolfe, The Bonfire of the Vanities[1], qui est aussi un roman des années 1980. Les années 1980 c’était un peu comme les années 1920 aux Etats-Unis, une période de grande richesse où beaucoup de choses se passaient sous le vernis. Les années 1920, c’était l’époque de Scott et Zelda Fitzgerald : culturellement c’était très fort, mais en même temps il y avait là un aspect très superficiel et très vivant. New York pendant les années 1980, c’était l’époque de la finance et de la cocaïne. Mais à l’époque, c’était également un demi-monde ; maintenant c’est devenu trop propre.
Vous connaissez peut-être cette citation de Thomas Jefferson, qui déclarait en 1802 : « Je pense que les institutions bancaires sont plus dangereuses pour nos libertés que des armées entières prêtes au combat. Si le peuple américain permet un jour que des banques privées contrôlent leur monnaie, les banques et toutes les institutions qui fleuriront autour des banques priveront les gens de toute possession, d’abord par l’inflation, ensuite par la déflation, jusqu’au jour où leurs enfants se réveilleront, sans maison et sans toit, sur la terre que leurs parents ont conquis ». Qu’en pensez-vous ?
Je pense que c’est un peu extrême. Mais on retrouve là des idées importantes. C’est très dangereux de ne mettre le pouvoir de la finance qu’entre les mains des banquiers, parce qu’ils ne sont pas très intéressés par la société en général, la propriété, la vie culturelle. Le capitalisme sans limite est très, très dangereux parce qu’il ne considère que le profit. C’est glauque.
Revenons à vos romans, en général, à présent. Vous y explorez beaucoup la thématique du conflit entre l’Amérique et l’Europe. Vous êtes assez critiques envers le fonctionnement de la société américaine. Vos livres n’ont pendant longtemps plus été édité aux Etats-Unis. Est-ce que, malgré tout, vous vous sentez un auteur américain ?
Oui, complètement. Je suis très américain, mais avec en même temps d’autres perspectives, parce que je vis comme une balle de ping-pong. Je suis tout le temps entre les Etats-Unis et l’Europe. Mais j’écris d’un point de vue différent de beaucoup d’auteurs américains parce que j’ai vécu en-dehors des Etats-Unis pendant trente-trois ans, ce qui fait que maintenant je suis un peu d’ici et de là !
Et qu’est-ce qui fait selon vous cette ligne de fracture entre les Etats-Unis et l’Europe ?
Je ne sais pas si c’est une ligne de fracture. Il y a surtout des conceptions philosophiquement très différentes. En Europe, on accepte l’idée que la vie est tragique, et la tragédie est un aspect de la vie. Aux Etats-Unis, on efface l’idée de la tragédie. Franchement, ça, c’est un gros défaut.
(Il éclate de rire)
Mais ça a des aspects positifs, par exemple, le fait qu’on est très optimiste et que la vie c’est un grand projet. Mais de l’autre côté, on n’arrive du coup pas à accepter le fait que la vie est souvent injuste et que les choses arrivent par hasard, ce qui est assez terrifiant.
Par exemple, après le 11 Septembre, aux Etats-Unis, tout le monde a demandé pourquoi cet événement horrible était arrivé. C’est un acte de terrorisme, point final. Moche, horrible, violent. Mais il a peut-être d’autres significations ? Grâce à mes années européennes, je pense que je suis suffisamment revenu de mes illusions. Mon point de vue a changé.
Vos personnages semblent toujours un peu perdus, un peu déracinés…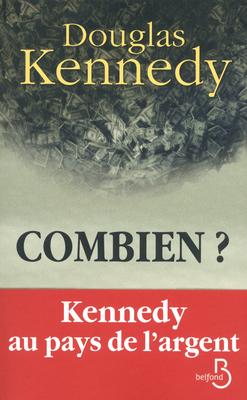
Comme tout le monde !
(Il rit à nouveau)
D’après mon expérience, tout le monde est perdu.
Vous aimez construire tout de même des personnages forts…
Les femmes, dans mes romans, sont très fortes. Les hommes ont toujours plutôt des caractères assez lâches.
En tous cas vos personnages ont toujours des personnalités très définies, des psychés très étudiées…
Mais ça c’est mon milieu. Dans mon prochain roman, qui va sortir en 2013, je parle d’un type qui n’a pas étudié dans les grandes écoles, et ma narratrice lit tout le temps. Le type est intelligent, mais avec des problèmes psychologiques, des peurs, des névroses… – Tout le monde a des névroses, c’est une des caractéristiques de la condition humaine. - Je ne pourrai jamais écrire des romans où les personnages n’ont pas des psychés complexes, parce que ce n’est pas mon milieu… Il faut écrire sur ce que l’on connaît !
Et pourquoi alors vos personnages féminins sont-ils très forts et vos personnages masculins plutôt lâches ?
Parce que c’est plus intéressant comme ça, et aussi parce que les femmes sont très complexes, tandis que beaucoup d’hommes sont lâches, d’après moi…
Vous êtes assez adeptes des retournements de situation finaux qui permettent de percevoir le roman d’une autre manière. Qu’essayez-vous de susciter chez le lecteur ? Quelle attitude de lecture aimeriez-vous provoquer ?
Je n’ai jamais pensé « Il faut faire ça… Il faut penser ça… » Mes romans sont très ouverts. Chaque lecteur ou lectrice peut en retirer sa propre interprétation. Il y avait tout à l’heure ici une femme qui m’a dit : « Vos romans finissent beaucoup sur des happy endings… » et j’ai répondu : « Quoi ?! » Typiquement, tout se passe mal dans mes romans ! Mais après, le narrateur ou la narratrice peut rebondir et on peut donc interpréter ça comme un happy ending. Je ne sais pas si vous avez lu Quitter le Monde, par exemple, mais à la fin elle peut recommencer. C’est comme la citation de Beckett que j’utilise dans le livre : « Je ne peux pas continuer, il faut continuer ». Ca, pour moi, c’est magnifique, et ça, c’est la vie.
Propos recueillis par Raphaëlle Chargois
Combien, de Douglas Kennedy, mai 2012, éditions Belfond.
[1] Le Bûcher des Vanités, 1987. Adapté au cinéma sous le même titre par Brian De Palma en 1990, avec notamment Tom Hanks, Bruce Willis, Mélanie Griffith et Morgan Freeman.











