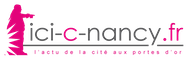En grande partie tourné à Nancy, Bye Bye Blondie y a par conséquent très naturellement été présenté en avant-première. A cette occasion, Virginie Despentes a accepté de répondre à nos questions sur cette histoire d’amour entre punk, plateaux télé et refus des normes...
En grande partie tourné à Nancy, Bye Bye Blondie y a par conséquent très naturellement été présenté en avant-première. A cette occasion, Virginie Despentes a accepté de répondre à nos questions sur cette histoire d’amour entre punk, plateaux télé et refus des normes...
C’était important pour vous de tourner à Nancy ?
Virginie Despentes : Ouais. C’est la ville où j’ai grandi. J’avais envie de filmer Nancy, j’aimerais bien la filmer plus. De la même façon que j’aimerais bien filmer Lyon, je trouve que les lieux où on a habité et où il s’est passé quelque chose de fort, c’est super intéressant de les filmer.
Ca vous a permis de faire le point, de filmer la ville de vos souvenirs ?
Virginie Despentes : Non, parce que le cinéma c’est surtout une série de contingences techniques : c’est jamais tes souvenirs là où ils sont arrivés ; c’est plus « Cet endroit est bien à filmer et c’est possible ». Le Totem, par exemple. C’est un endroit que je n’ai jamais connu à Nancy mais c’était bien à filmer.
Mais j’imagine qu’il y a tout-de-même là quelque chose d’un peu magique, une sorte de réconciliation. Je suis allée filmer la maison de mon enfance, à Jarville-La-Malgrange, par exemple. Je n’ai pas tellement eu le temps de me poser depuis le tournage, mais si j’y réfléchis, j’imagine qu’il y a des choses que j’ai essayé de résoudre en venant ici. C’était vraiment important, et j’ai adoré filmer l’extérieur, par exemple la Porte de la Craffe, dans la scène de la baston.
J’aurais aimé aussi pouvoir filmer des acteurs lorrains, avec l’accent. C’est ce que je voulais faire au début, mais ça a été matériellement impossible : ça s’est passé trop vite, la technique était surtout à Paris… Mais c’est quelque chose que j’aimerais bien pouvoir faire un jour, parce que je crois que c’est un accent qu’on n’entend jamais ; j’ai l’impression d’aller au cinéma depuis des années sans jamais entendre l’accent de chez moi.
Comment s’est fait le changement de la relation hétérosexuelle du livre en couple homosexuel ?
Virginie Despentes : Le changement, techniquement, c’est parti d’une conversation avec Béatrice Dalle. Parce que je ne savais pas pour quel acteur écrire le scénario et elle m’a dit : « Mais toi, tu es avec une fille. Pourquoi tu n’écrirais pas le scénario pour une autre comédienne ? Tu ne vas pas passer deux mois à ne pas réussir à écrire ! » Et effectivement dès qu’elle me l’a dit, le projet, pour moi, est devenu intéressant. D’abord parce que j’ai pensé à Emmanuelle Béart ; et parce qu’effectivement, dans la vie, je suis avec une fille depuis sept ans maintenant et que j’ai bien remarqué qu’il y avait très peu de films à propos de deux femmes qui avaient des histoires ensemble.
Revenons sur le fait que vous avez écrit cette histoire à propos d’un couple hétéro, que pour le film vous avez transposé en couple homo. Vous avez expliqué avoir fait regarder The L World aux actrices pour qu’elles puissent se représenter comment construire le couple lesbien à l’écran, parce qu’on ne voit pas beaucoup ça au cinéma. A votre avis pourquoi cette réticence à montrer le couple homosexuel, et particulièrement lesbien, au cinéma ? Qu’est-ce qui pose problème dans la représentation du couple lesbien ?
Virginie Despentes : Ce qu’il y a d’intéressant pour moi dans le fait de sortir le film, c’est justement d’essayer de comprendre si ça pose un problème particulier. Par exemple : est-ce que j’ai l’impression de sortir là quelque chose de vraiment différent des romans que j’ai sortis avant ? Est-ce qu’il y a une gêne, une réticence ? Tout ça, ce sont des choses que je ne connais pas encore… Qu’est-ce que c’est que de travailler avec l’imagerie lesbienne ?
Ce que je sais en revanche, c’est qu’au cinéma en général, on représente peu de gens. On a mis des années à représenter des rebeus ou des blacks par exemple, en France. Moi qui ai 40 ans, je sais qu’on a attendu un moment pour ça, et puis petit à petit, ça s’est débloqué. On a vu arriver dans des vrais rôles des rebeus ou des blacks. Quand Le Thé au Harem d’Archimède, qui était un des premiers films où on voyait des rebeus dans les cités – alors qu’ils sont là depuis longtemps ! – est arrivé en 1986 ou 1984 ou dans les années 80 – je ne sais plus exactement[1] –ça a été un choc parce que jusqu’alors on n’avait pas réalisé qu’ils étaient là !
Comme c’est beaucoup d’argent et qu’il faut beaucoup d’autorisations de la part de ceux qui ont le pouvoir, le cinéma est très lent, en fait, à représenter les minorités. Même L’Esquive ça a été une grande première, en France, presque une révolution. L’histoire des représentations au cinéma de ce qu’on appelle « les minorités invisibles » évolue très lentement. Les lesbiennes en font partie, et du coup après les Arabes et les Noirs, on va peut-être aussi pouvoir enfin arriver à l’écran !
Il semble y avoir un contraste entre les flashbacks où c’est le personnage de Frances qui est la plus masculine, la plus directe, celle qui sait le plus ce qu’elle veut ; et l’âge adulte où se produit le rapport inverse, peut-être aussi parce que dans son milieu professionnel, il faut être très carrée, il faut qu’elle soit mariée… (Frances déclare clairement qu’elle ne veut pas « passer pour la gouine de la télé »…) Et puis ensuite ça s’inverse : Gloria qui à l’origine, n’était pas aussi assurée dans son rapport à l’homosexualité, vient la réveiller pour la pousser à s’affirmer. Est-ce que la transformation de la relation hétéro en relation homosexuelle vous a été utile de ce point de vue ? Vous a-t-elle aussi permis de jouer plus aisément sur cette façon d’assumer les rôles de genre ?
Virginie Despentes : Effectivement il y a un jeu sur les personnages qui se transforment, qui vont tout le temps se chercher l’une et l’autre … D’abord c’est Frances vient chercher Gloria. Elle est très grande gueule, mais Gloria vient tout de suite et elle est très sûre de ce qu’elle veut. Gloria demande à Frances d’assumer publiquement ce qu’elle est, parce qu’elle ne veut pas rester cachée…
Même quand elles sont petites, c’est tout le temps Frances qui vient chercher Gloria, et c’est Gloria qui est quittée…
Mais je pense que ce n’est pas spécifique à une relation lesbienne ou hétéro. Dans le rapport amoureux, il y a surtout un jeu permanent de pouvoir que l’un prend sur l’autre ; et que l’autre rend, reperd et reprend. Même lorsque l’un domine l’autre. Enfin moi, je le vois comme ça… Je pense qu’on peut le prendre comme un jeu du rapport amoureux. Et pour moi il n’y a pas de différence entre une relation lesbienne ou hétéro dans ce domaine-là.
Vous aviez envie de déclarer dans ce film quelque chose contre la normativité de la société ? Car il semble beaucoup en être question… Par exemple quand Gloria est internée de force à l’hôpital psychiatrique, et que le psychiatre lui fait des remarques sur son style vestimentaire. Ce à quoi elle répond : « Ah, c’est pour ça que je suis ici, parce que vous n’aimez pas mon look ? » Ou encore dans le regard qui est porté sur le couple lesbien, ou sur les jeunes punks qui ne font rien de mal mais sont perçus comme suspects quand même…
Virginie Despentes : Oui bien sûr. Ça m’intéresse ce discours sur la normativité de la société. De le décaler légèrement, oui, ça m’intéresse beaucoup. Et encore plus dans une forme mainstream, à l’aide d’une façon de filmer les images très classique. J’espère faire passer des représentations un tant soit peu différentes. Rien que le fait de raconter l’histoire de deux lesbiennes heureuses, c’est déjà très non-normatif ! En vérité, raconter une histoire d’amour vécue par deux femmes de plus de quarante ans et qui se passe très bien, ça parait déjà extraordinaire, et c’est important pour moi de le faire. Parce que le cinéma forme les esprits. C’est une propagande très forte. Et que si on représente des femmes de plus de quarante ans qui s’épanouissent dans l’amour, il me semble qu’on dit quelque chose de très important au monde. Je crois que oui, le cinéma c’est vraiment une propagande. Bien plus que la littérature. Le cinéma nous crée les cerveaux dans lesquels on pense. Donc, dans Bye Bye Blondie, j’espère avoir su régler deux ou trois petites choses suffisamment différemment, de façon à créer des cerveaux dans lesquels on va pouvoir penser un peu différemment.
[1] En réalité, le film de Mehdi Charef, Le Thé au Harem d’Archimède est sorti en… 1985 ! Pas loin, donc !